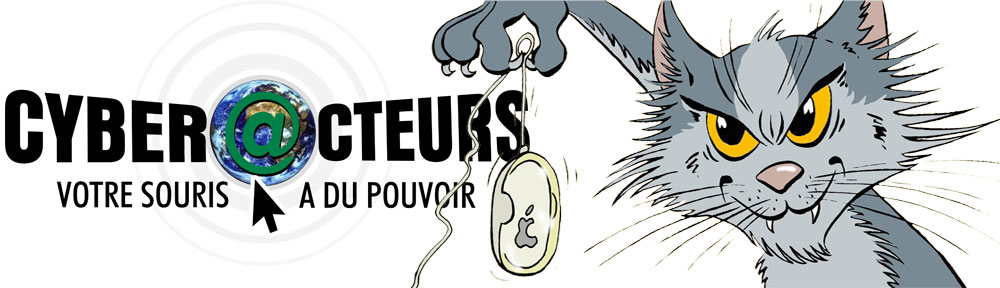Coût, gestion des déchets et sécurité : huit questions que pose le retour annoncé du nucléaire en France
Emmanuel Macron a dit vouloir de nouveaux réacteurs, au nom de l’indépendance énergétique de la France et de la préservation du climat. Mais où en est la filière et que suppose ce choix ?
Par Perrine Mouterde, Adrien Pécout et David Larousserie Le Monde
Quelle place la France doit-elle accorder au nucléaire dans le cadre de sa transition énergétique ? En annonçant, sans entrer dans le détail, mardi 9 novembre, sa volonté de relancer le programme nucléaire français, le président Emmanuel Macron a pris position et contribué à imposer le débat à cinq mois de la prochaine élection présidentielle.
Avec ses 56 réacteurs et ses quelque 70 % d’électricité d’origine nucléaire, la France jouit de l’un des systèmes électriques les plus décarbonés d’Europe. Mais son parc, construit entre les années 1970 et 1990, le deuxième plus important dans le monde derrière les Etats-Unis, est vieillissant : 36 ans de moyenne d’âge. Pour des raisons de vétusté, il devra en grande partie être mis à l’arrêt d’ici à la moitié du siècle.
Le pays sera donc amené à remplacer cette importante capacité de production électrique bas carbone. En parallèle, pour tenir ses objectifs climatiques et réduire sa consommation encore majoritaire d’énergies fossiles, il lui faudra surtout produire 35 % de térawattheures d’électricité de plus qu’aujourd’hui d’ici à 2050, selon le scénario central de Réseau de transport d’électricité (RTE), le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité.
Dans ce contexte, la France doit-elle lancer un programme afin de construire en série d’autres réacteurs de nouvelle génération, les EPR (sigle anglais pour « réacteur pressurisé européen ») ? Ou bien ferait-elle mieux de tout miser sur les énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire, et sortir progressivement du nucléaire ? A ce sujet, opinion, experts et politiques restent divisés.
De nouveaux réacteurs sont-ils indispensables face au défi climatique ?
Pour ses partisans, se passer de l’atome à l’heure de l’urgence climatique serait une aberration. Le nucléaire est, avec l’éolien, la source d’énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre au cours de son cycle de vie, soit de l’extraction du minerai au démantèlement des installations. D’après l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le nucléaire a permis d’éviter dans le monde au moins l’équivalent de 60 gigatonnes de CO2 depuis 1970, soit cinq années d’émissions mondiales du secteur électrique. Les réacteurs ont aussi l’avantage de produire de l’électricité à la demande et de manière continue, contrairement aux éoliennes et aux panneaux solaires, dont la production varie avec la météo ou le cycle jour/nuit. Ils sont, pour leurs défenseurs, un complément incontournable au développement des renouvelables.
Au niveau mondial, les grandes institutions, dont l’Agence internationale de l’énergie (AIE), misent sur une augmentation des capacités de production nucléaire au cours des prochaines décennies. « Le défi du changement climatique est tellement immense que nous ne pouvons nous permettre d’exclure des technologies bas carbone », estime Fatih Birol, le directeur général de l’AIE. La part globale de l’atome dans la production mondiale d’électricité restera toutefois limitée – moins de 10 %, selon l’AIE.
Pour les opposants au nucléaire en revanche, la construction de nouveaux réacteurs n’est pas nécessaire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Ils pointent d’abord la question des délais : en France, la mise en service d’une première paire d’EPR ne devrait pas intervenir avant, au mieux, 2035 ou 2040. Ils ne contribueront donc pas à la très forte réduction des émissions attendue d’ici à 2030. Des experts et des ONG avancent que la priorité, pour répondre rapidement au défi du réchauffement, est plutôt d’agir sur la maîtrise de la consommation et l’efficacité énergétique, tout en développant les renouvelables et les solutions de flexibilité, comme notamment le stockage par batterie. Dans son rapport publié le 25 octobre, le gestionnaire national RTE laisse le débat ouvert. Sur les six scénarios permettant tous d’atteindre la neutralité carbone en 2050, trois misent sur la mise en service de nouveaux réacteurs.
La filière est-elle capable de construire de nouveaux réacteurs ?
La France a longtemps vécu sur son parc historique. Une dizaine d’années sépare la mise en service du dernier réacteur inauguré à Civaux (Vienne), en 1999, et le lancement, en 2007, du chantier actuel de Flamanville (Manche). Un « trou » qui a notamment conduit à « une perte de compétences généralisée », comme l’a pointé en 2019 le rapport Folz portant sur les déboires du chantier de Flamanville.
Ces dernières années, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) s’est également inquiétée à plusieurs reprises de la « capacité industrielle d’EDF et des intervenants de la filière » dans le cadre des travaux colossaux engagés actuellement pour prolonger de dix ans l’activité des réacteurs déjà existants. Fin 2020, son président, Bernard Doroszczuk, rappelait que le secteur devait, d’une certaine façon, faire ses preuves : « La filière se mobilise pour qu’il y ait de nouveaux grands projets », mais « il faut d’abord qu’elle démontre sa capacité à réussir le réexamen » des réacteurs atteignant l’âge de 40 ans. « C’est en quelque sorte un test préalable », insistait-il.
Aujourd’hui, la filière se déclare « prête » à reprendre les grands travaux, comme le groupe Electricité de France (EDF) l’a encore affirmé, le 8 novembre, à l’occasion d’un point d’étape du « plan Excell ». Depuis 2019, le groupe coordonne ce « plan d’excellence de la filière nucléaire » visant à restaurer « la confiance » et à « fabriquer conforme du premier coup ». L’électricien national souligne qu’à la différence des premiers EPR, qui s’apparentaient à un prototype de tête de série, les nouveaux réacteurs reposeront sur une conception simplifiée. Par exemple, « la diversité des robinets en catalogue a été divisée par 10, passant de 13 000 [pour l’EPR de Flamanville] à 1 200 références [pour les futurs EPR]. »
En parallèle de Flamanville, EDF a participé au lancement effectif du premier EPR dans le monde en 2018 : celui de Taishan, en Chine, où une fuite de gaz rares a déjà entraîné une mise provisoire à l’arrêt. Le groupe mène aussi un projet, toujours en cours, au Royaume-Uni (Hinkley Point C). « Pour aller au bout des investissements nécessaires, les entreprises auront besoin de visibilité », souligne Cécile Arbouille, déléguée générale du Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire. La filière française, qui revendique 220 000 emplois directs et indirects, estime qu’une nouvelle paire de réacteurs pourrait représenter 10 000 emplois supplémentaires. Mme Arbouille espère attirer « les bonnes compétences au bon moment », alors que le pays manque par exemple de soudeurs, toutes filières confondues.
Combien coûterait la relance d’un programme nucléaire et qui le paierait ?
A Flamanville, la facture s’est envolée : de 3,3 milliards d’euros envisagés en 2007, l’enveloppe globale pourrait atteindre 19,1 milliards d’euros en 2023 (dont 12,4 milliards de coûts de construction), selon la Cour des comptes. Pour autant, EDF l’assure : le lancement de six nouveaux EPR permettrait d’abaisser les coûts, du fait d’une production en série. L’exploitant table aujourd’hui sur un coût de 46 milliards d’euros pour la construction de trois nouvelles paires de réacteurs, quand les ministères de la transition écologique et de l’économie envisagent déjà une fourchette supérieure, de 52 à 64 milliards d’euros, selon un document de travail révélé par le média Contexte.
Les modalités exactes du financement n’ont pas encore été tranchées, et ne seront pas neutres pour EDF (dont l’Etat détient la majorité des parts), déjà fortement endettée. Le déploiement de nouveaux réacteurs nécessiterait une implication des pouvoirs publics, par exemple sous forme de garantie d’emprunt. « Les coûts de production d’électricité dépendront beaucoup du schéma financier, un peu comme s’il s’agissait d’une voiture pour laquelle vous payez chaque mois, explique Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d’énergie nucléaire. Tout dépendra du taux auquel vous avez emprunté. » L’Etat lève en effet de l’argent sur les marchés à de bien meilleurs taux que les acteurs privés.
Dans son rapport du 25 octobre, RTE estime, en se fondant sur une hypothèse centrale d’un coût de financement assez faible (4 %), que construire de nouveaux réacteurs est « pertinent du point de vue économique ». Malgré des « coûts bruts de production des nouvelles centrales nucléaires (…) en moyenne plus élevés que ceux associés aux grands parcs d’énergies renouvelables », et malgré les montants nécessaires au retraitement et au stockage des déchets radioactifs comme au démantèlement futur des sites, les scénarios les plus nucléarisés « peuvent conduire, à long terme, à des coûts plus bas pour la collectivité qu’un scénario 100 % renouvelables ».
Pour le système électrique, la méthode de calcul retenue par RTE est celle des « coûts complets annualisés ». En raison de leur caractère intermittent, les énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire supposent davantage de capacités d’acheminement ou de flexibilité (stockage, pilotage de la demande et nouvelles centrales d’appoint).
La conclusion de RTE ne convainc pas les opposants au nucléaire, qui soulignent la très forte chute des coûts du solaire et de l’éolien observée ces dernières années. « En prenant en compte l’incertitude liée aux hypothèses [prises par RTE], les différents scénarios relèvent des mêmes ordres de grandeur en matière de coûts : il n’y a pas véritablement d’avantage économique du nucléaire », estime Greenpeace. Selon l’étude de RTE, le scénario du mix électrique à l’horizon 2060 le moins coûteux (et aussi le plus nucléarisé) représenterait 59 milliards d’euros par an, contre 80 milliards pour le scénario le plus onéreux (sans nouveau nucléaire).
Le nouveau nucléaire présente-t-il des gages de sûreté ?
Dans son bilan annuel 2020 sur l’état des installations du parc, Bernard Doroszczuk indique que la sûreté s’est « globalement améliorée » en 2020, tout en pointant la persistance de « points d’attention ». Les futurs EPR2, s’ils voient le jour, seront-ils plus sûrs que les réacteurs actuels ? Le gendarme du nucléaire a validé, en 2019, les « options de sûreté » proposées par EDF pour ces futures installations, qui devraient garantir le même niveau de sûreté que l’EPR de Flamanville.
« La vraie marche en matière de sûreté se trouve entre les réacteurs dits de deuxième génération, qui fonctionnent actuellement en France et dont la conception date des années 1970, et la troisième génération, dont font partie Flamanville 3 et les EPR2 », précise Julien Collet, le directeur général adjoint de l’ASN. La troisième génération prend notamment en compte, dès sa conception, le risque d’un accident avec fusion du cœur et celui d’agressions externes, telles que des séismes ou des inondations extrêmes.
Malgré ces progrès, les opposants rappellent que la France ne sera jamais totalement à l’abri d’un accident, citant les catastrophes de Tchernobyl (1986) et de Fukushima à la suite d’un tsunami (2011). Les conséquences pour les populations ou l’environnement peuvent être majeures. Ils estiment aussi que le système de contrôle de la sûreté, qui repose notamment sur le principe de la déclaration des incidents par EDF, n’est pas suffisant.
Sait-on gérer les déchets et démanteler les installations ?
Outre le risque d’accident ou d’atteintes à l’environnement, la gestion des déchets est le sujet qui préoccupe le plus les opposants au nucléaire. Fin 2019, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs stockait 1,67 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Les plus dangereux ne représentent qu’une toute petite part de ce volume : 3 % d’entre eux concentrent plus de 99 % de la radioactivité – ils resteront radioactifs jusqu’à des centaines de milliers d’années. Actuellement entreposés dans les installations d’Orano à La Hague (Manche), ils pourraient à terme être enfouis sous 500 mètres d’argile à Bure, dans la Meuse.
Le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), encore fortement contesté, attend sa reconnaissance d’utilité publique, qui pourrait être déclarée dans les prochaines semaines. A l’échelle mondiale, aucun site de stockage définitif de ces déchets de haute activité n’a encore été mis en service, à l’exception d’une installation pilote aux Etats-Unis pour des déchets issus du programme militaire.
Au-delà de Cigéo, l’ASN a multiplié les alertes concernant le risque que des « filières de gestion sûres » ne soient pas disponibles dans les quinze à vingt ans à venir pour les autres types de déchets, faute de décisions politiques rapides. A La Hague, les piscines où sont entreposés les combustibles usés seront saturées à l’horizon 2030. Même chose pour l’installation abritant les déchets très faiblement radioactifs à Morvilliers (Aube), alors que d’autres produits, comme des éléments conditionnés dans du bitume, n’ont toujours aucune solution de stockage pérenne.
Les partisans du nucléaire avancent, de leur côté, que la filière a fait la démonstration, depuis quarante ans, de sa capacité à gérer les déchets qu’elle produit sans impact sanitaire ou sur l’environnement. « Les déchets les plus dangereux sont en très petite quantité par rapport au service qu’ils nous rendent, insiste Myrto Tripathi, présidente de l’association Voix du nucléaire. Et Cigéo est une solution pour les gérer. »
Concernant le démantèlement, neuf réacteurs de quatre technologies différentes sont actuellement « en cours de déconstruction en France », selon EDF. Le plus ancien se trouve à Chinon (graphite gaz) et sa mise à l’arrêt remonte à… 1973. La déconstruction des réacteurs de deuxième génération (à eau pressurisée), qui constituent la majorité du parc, coûterait selon l’exploitant entre « 350 et 400 millions d’euros » par unité. Outre ceux de Fessenheim (Haut-Rhin) en 2020, seuls deux réacteurs de cette catégorie ont déjà été arrêtés sur le site de Chooz (Ardennes) : la fin de leur démantèlement est prévue pour 2024, soit trente-trois ans après leur mise à l’arrêt. A l’avenir, EDF espère accomplir ses prochaines déconstructions en une quinzaine d’années de travaux.
En quoi le nucléaire est-il un gage d’indépendance ?
Depuis le début, le nucléaire repose sur l’idée d’une certaine souveraineté de la France. En mars 1974, moins d’un an après le choc pétrolier, le plan Messmer, du nom du premier ministre d’alors, avait un objectif : se passer d’importations d’hydrocarbures pour la production nationale de l’électricité, à partir des centrales réparties dans le pays. Aujourd’hui encore, alors que la consommation d’énergie repose en France principalement sur des importations d’énergies fossiles, les partisans du nucléaire soulignent l’intérêt d’une source d’énergie produite sur le territoire.
En partie grâce à l’atome, la France produit sur son sol un peu plus de la moitié de son énergie consommée (54,6 % en 2019). Pour autant, ce pourcentage baisserait significativement si l’Agence internationale de l’énergie et Eurostat prenaient en compte l’origine du minerai nécessaire à la combustion nucléaire. Le pays importe environ 8 000 tonnes d’uranium naturel par an, notamment en provenance du Kazakhstan, du Canada et du Niger. « La géopolitique de l’uranium n’est pas du tout la même que celle des énergies fossiles, la répartition de l’uranium est plus homogène sur terre et il se stocke très facilement pendant plusieurs années », précise Michel Berthélemy, économiste à l’Agence pour l’énergie nucléaire, rattachée à l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Le minerai étant présent dans une variété de pays et sur tous les continents, les risques de dépendance à tel ou tel pays sont moindres. « L’uranium représente à peu près 5 % du coût global de production de l’électricité », indique le groupe Orano, spécialisé dans les métiers du combustible, pour signifier que les fluctuations des cours de ce minerai ne modifieraient qu’à la marge la facture totale.
Un débat démocratique est-il possible ?
Après l’annonce du président sur la construction de nouveaux réacteurs, les détracteurs du nucléaire ont dénoncé une décision « antidémocratique » et « unilatérale ». « S’il s’était exprimé en tant que candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron aurait été tout à fait légitime à se prononcer en faveur d’une relance du nucléaire, a par exemple réagi France Nature Environnement. Le problème, c’est qu’il a annoncé cette relance en tant que président. Les citoyennes et citoyens méritent d’être maîtres de l’avenir énergétique et décarboné de la France à travers un vrai et riche débat démocratique. » « Ce n’est pas en imposant des décisions depuis l’Elysée que l’on réussira notre transition énergétique », a aussi estimé Greenpeace.
De fait, la construction – ou non – de nouveaux réacteurs ne sera mise en œuvre que lors du prochain quinquennat, en fonction du candidat qui aura été élu. Avec cette annonce, Emmanuel Macron a surtout clarifié sa position dans le cadre de la campagne présidentielle. « Au moins ses intentions sont claires, estime Nicolas Goldberg, analyste énergie auprès du cabinet Colombus Consulting. Et il y aura forcément des débats au Parlement, dans le cadre d’un projet de loi de finances à propos du financement, autour de la régulation, pour la mise à jour de la programmation pluriannuelle de l’énergie… » Ce document, qui constitue la feuille de route énergétique de la France, doit être révisé d’ici à 2023.
Au Parlement, une quinzaine de députés ont déposé mi-octobre une proposition de loi pour renforcer les pouvoirs du Parlement sur la stratégie nucléaire, en instituant diverses mesures de transparence afin que les élus puissent se prononcer « de façon éclairée sur des choix qui engagent l’avenir de toute une nation ». Les citoyens pourraient être consultés lors du choix des sites retenus pour implanter de nouveaux réacteurs, si leur construction était effectivement lancée.
Où en est la recherche sur le nucléaire ?
Fin août 2019, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) décidait d’abandonner un projet de recherche sur un nouveau type de réacteur nucléaire, dit de quatrième génération, Astrid. « Astrid constituait le programme phare de la recherche nucléaire française. L’industrie nucléaire française ne dispose plus aujourd’hui de projet comparable de long terme, permettant aux chercheurs de confronter et valider de nouvelles options technologiques », résume un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques du 8 juillet (Opecst), qui craint « un risque de perte de l’acquis de soixante-dix ans de recherche ».
Sur les six concepts de quatrième génération qu’explorent Etats-Unis, Russie, Chine ou Inde, la France ne conserve des compétences que sur deux. La famille Astrid, dite des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, et celle dite des sels fondus, où le combustible est liquide, mélangé à des sels qui servent aussi de caloporteurs. Ces deux technologies consomment mieux l’uranium et peuvent aussi « brûler » le plutonium ou d’autres produits, permettant de réduire les déchets à traiter et de limiter les risques de dépendance à l’uranium.
Une autre voie de recherche est également explorée sans projet de prototype en France, les réacteurs pilotés par accélérateur de particules, pour transmuter la matière, c’est-à-dire transformer des éléments radioactifs en éléments de plus courte durée de vie ou moins actifs. Depuis octobre, le plan d’investissements France 2030 a porté l’attention sur les « petits réacteurs modulaires », de plus faible puissance et n’impliquant pas de rupture technologique. Le projet Nuward, entre notamment EDF et le CEA, doit déboucher sur un démonstrateur vers 2035. Mais il se destine principalement à l’export.
Finalement, le projet le plus concret en recherche nucléaire est le réacteur international ITER, en cours de construction dans les Bouches-du-Rhône, dont le but est de démontrer la capacité à générer de l’énergie par la fusion nucléaire, plutôt que par la fission, le principe qui anime jusqu’à présent tous les réacteurs.