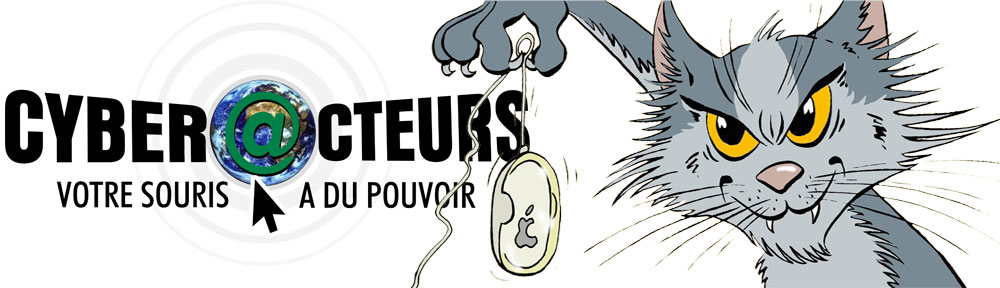Bonjour,
ÉDITORIAL Jérôme Fenoglio Directeur du « Monde »
Relancer un chantier colossal de plusieurs EPR, comme le souhaite le président Macron, a de très nombreuses implications, budgétaires, environnementales, technologiques… A quelques mois de la présidentielle, les Français méritent un débat public sérieux et transparent, qui s’appuie sur des chiffres et des arguments de qualité.
Editorial du « Monde ». En France comme ailleurs, les campagnes en vue d’une élection présidentielle apportent souvent autant de clarifications bienvenues que de simplifications malheureuses. Ces dernières semaines, les candidats virtuels ou déclarés au scrutin du printemps 2022 ont précisé leur position sur une question rendue impérieuse par l’ampleur de la crise climatique en cours : l’évolution de notre production d’énergie, principalement électrique, dans le cadre d’une trajectoire rigoureuse de réduction de nos émissions de CO2. Pour produire cette électricité décarbonée, notre pays possède un atout qui est devenu source de perplexité. Notre parc nucléaire, contributeur à hauteur d’environ 70 % du mix actuel, entre dans la dernière phase de sa vie et ne sera quasiment plus opérationnel dans une vingtaine d’années.
C’est sur son sort que les options défendues par les candidats ont tendance à basculer dans le simplisme. A droite, et à l’extrême droite, l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 est perçu comme une occasion d’offrir une revanche historique à la filière nucléaire, tout en évacuant toutes les questions gênantes : le nécessaire effort de réduction de la consommation d’énergie ainsi que l’indispensable développement des énergies renouvelables, notamment ces éoliennes devenues, pour ceux de ce bord politique, l’objet de tous les griefs. A gauche et chez les écologistes, à quelques exceptions près, la sortie rapide du nucléaire est toujours à l’ordre du jour, même si sa date prévue a été légèrement décalée. Ce report serait toutefois loin de nous éviter les nombreuses difficultés dans lesquelles nous voyons aujourd’hui se débattre l’Allemagne, après la décision d’un arrêt précipité de ses centrales, à la suite de la catastrophe de Fukushima.
Entre ces illusions du tout et celles du rien, Emmanuel Macron vient de se prononcer pour une relance de la construction de plusieurs centrales de type EPR, concomitante avec une accélération dans les énergies renouvelables, au sein d’un mix décarboné dont les proportions exactes doivent être encore choisies parmi les modélisations présentées récemment par le Réseau de transport d’électricité (RTE). Cette option, présentée comme rationnelle et raisonnable, n’en constitue pas moins, elle aussi, un pari sur l’avenir, comportant de nombreux risques qui devraient être beaucoup plus mûrement réfléchis et débattus avant de s’imposer comme une décision du président de la République.
D’abord parce que ses implications budgétaires sont considérables. Le renouveau, même limité, de l’atome en France, c’est avant tout l’allocation d’une manne financière à la fois immense et imprévisible. Songeons que l’EPR de Flamanville devait être connecté au réseau en 2012 après un investissement de quelque 3 milliards d’euros et qu’il ne devrait finalement entrer en service qu’une décennie plus tard, pour un budget de six à sept fois supérieur. Les problèmes techniques rencontrés depuis par l’un des deux réacteurs de l’EPR de Taishan (Chine) laissent craindre que les retards et dérives budgétaires soient plus une norme qu’une exception. Or les ressources d’argent public considérables qui seront consenties au nucléaire manqueront d’autant à la recherche de solutions techniques de stockage de l’énergie et d’adaptation des réseaux, aux renouvelables, à l’accompagnement des mesures de sobriété énergétique…
Les défauts en série sur le chantier de Flamanville, les inquiétudes maintes fois exprimées par l’Autorité de sûreté nucléaire et la situation financière désastreuse d’EDF ne peuvent qu’inciter à la prudence. Lancer un chantier colossal de plusieurs EPR implique pour les pouvoirs publics de disposer de garanties indépendantes sur la capacité d’EDF et de ses sous-traitants à mener à bien ce défi. Cette circonspection s’impose d’autant plus que les futures centrales pourraient fonctionner dans un milieu déréglé par l’effet d’un réchauffement climatique qui aura grand-peine à être maîtrisé. Dans un tel monde, ni le débit des fleuves, ni l’étendue des inondations, ni les dégâts que les ondes de tempêtes peuvent causer sur les littoraux ne sont pleinement anticipables. Comme n’était pas prévisible ou même imaginable la brutalité des inondations qui ont ravagé la Belgique et l’Allemagne cet été. A mesure que le climat change, l’improbable devient plausible, l’impensable s’impose dans l’actualité. Les risques faibles d’aujourd’hui sont les catastrophes de demain.
Ces nouvelles menaces, comme les dangers plus anciens – la lancinante question des déchets est toujours posée –, doivent être portées à l’attention du grand public. Tout comme les difficultés du démantèlement des centrales en fin de vie, le renchérissement prévisible des tarifs, les instabilités des sources renouvelables, l’adaptation inévitable de notre consommation et de nos modes de vie à cette nouvelle donne. Sur l’ensemble de ces sujets, nos concitoyens méritent un débat public sérieux et transparent, qui s’appuie sur des chiffres et des arguments de qualité. Cela passe tout autant par un effort de la filière nucléaire, qui a fini par se nuire à elle-même en se complaisant dans sa culture de l’opacité, que par une revitalisation de nos échanges démocratiques. Avant que le prochain président de la République ne présente ses orientations devant des citoyens – et leurs représentants – pleinement éclairés, les échanges entre candidats ne pourront pas se limiter à une stigmatisation stérile de l’atome ou de l’éolien.
Au-delà du gaz et du pétrole, Moscou est également un acteur clé du secteur de l’atome et de nombreux pays entretiennent des liens étroits avec le géant Rosatom. Mais cette industrie reste épargnée par les sanctions.
Par Perrine Mouterde et Marjorie Cessac
Le Monde
Gaz, pétrole, charbon. La guerre en Ukraine, en provoquant une crise énergétique d’ampleur inédite, a clairement exposé les liens des pays européens avec le secteur des hydrocarbures russes. Mais une autre dépendance a jusqu’ici été très peu évoquée : dans l’est de l’Union européenne (UE) notamment, des Etats comptent sur l’industrie nucléaire russe pour faire tourner leurs centrales et produire jusqu’à la moitié de l’électricité dont ils ont besoin.
Alors que le géant de l’atome Rosatom est un réel instrument d’influence pour le pouvoir de Vladimir Poutine, qu’il est chargé des armes nucléaires du pays et impliqué dans l’occupation de la centrale de Zaporijia en Ukraine, ce secteur a jusqu’ici été épargné par les sanctions. Un statu quo qui ne devrait pas empêcher le marché de se restructurer au moins en partie, en bénéficiant au passage à des acteurs français.
Rosatom, champion toutes catégories
Un chiffre illustre le poids de la Russie dans l’industrie nucléaire : sur quelque 440 réacteurs en opération à travers le monde, 80 sont de conception russe, soit de type VVER. Au cours des dernières décennies, le pays a exporté plus d’unités que n’importe quel autre acteur.
L’UE en compte dix-huit sur une centaine en activité, notamment dans les pays de l’ex-bloc soviétique. En Bulgarie, par exemple, les deux réacteurs russes fournissent un tiers de l’électricité du pays. En République tchèque, les six unités sont à l’origine de près de 37 % de la production tandis qu’en Hongrie les quatre réacteurs en produisent près de la moitié.
Moscou continue par ailleurs de dominer le marché international. Selon le World Nuclear Industry Status Report, sur les cinquante-trois réacteurs en cours de construction à la mi-2022, vingt l’étaient par le groupe Rosatom, dont dix-sept hors de Russie. Seules la France et la Corée du Sud construisent également des réacteurs (deux chacun) hors de leurs frontières.
Avec plus de 300 entreprises, 275 000 employés et des partenariats commerciaux signés avec plus de cinquante pays, l’Agence fédérale de l’énergie atomique Rosatom est un mastodonte. Impliquée dans la quasi-totalité des pays nucléarisés, elle a été créée officiellement, en 2007, par le président russe. « Vladimir Poutine a réuni cette année-là les activités nucléaires du secteur public et du secteur privé, raconte Mark Hibbs, spécialiste de la politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace. Il a centralisé l’ensemble de l’industrie, y compris le nucléaire militaire, au sein d’une seule organisation placée directement sous ses ordres. »
Depuis, Rosatom a mené une stratégie offensive, en proposant de livrer des centrales « clés en main ». Non seulement la Russie construit, assure la maintenance, fournit l’expertise technique ou le combustible, mais elle peut aussi prendre en charge le coût financier, même pour des opérations considérées comme à risque.
« Les Russes sont hypercompétitifs »
Un tel contrat, pour quatre réacteurs estimés à environ 20 milliards de dollars (un peu plus de 19 milliards d’euros), a ainsi été signé en 2010 avec la Turquie, qui cherchait en vain depuis des décennies à lancer un programme nucléaire. « Les Russes sont hypercompétitifs, personne au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] ne peut rivaliser avec les conditions qu’ils proposent », souligne Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du centre énergie et climat de l’Institut français des relations internationales.
Concernant l’uranium naturel, la Russie était en 2021 le troisième fournisseur de l’UE avec 20 % des parts de marché, selon l’agence européenne Euratom. Le Kazakhstan figure en deuxième position ; or une certaine part de l’uranium extrait dans ce pays enclavé transite par le territoire russe. « Environ 45 % de l’uranium français vient de l’Ouzbékistan et du Kazakhstan, des régimes sous influence russe, et transite dans des cargos russes, ce n’est pas neutre », dénonce Pauline Boyer, chargée de campagne nucléaire à Greenpeace.
Quel est le niveau de dépendance des pays européens au gaz et au pétrole russe ?
Une fois extrait, l’uranium naturel doit également être « converti » – le minerai est purifié et transformé en hexafluorure d’uranium (UF6) – puis « enrichi » – la concentration d’uranium 235 est augmentée – avant de pouvoir être utilisé sous forme de combustible. Là aussi, Rosatom exerce un poids réel : le groupe contrôle 25 % du marché européen de la conversion et 31 % de celui de l’enrichissement – des chiffres qui grimpent à environ 40 % et 46 % au niveau mondial.
Outre l’UE, les Etats-Unis sont également lourdement dépendants de la Russie. « A tout moment, Moscou pourrait réduire de moitié l’approvisionnement mondial disponible en combustible nucléaire, et le marché le plus exposé au monde est les Etats-Unis », estimait fin octobre Paul Dabbar, ancien secrétaire adjoint du ministère américain de l’énergie. En 2021, Rosatom a fourni près du quart du combustible nécessaire aux 93 réacteurs du parc américain. La plupart des modèles de réacteurs avancés dits « de quatrième génération », en cours de développement, ont par ailleurs besoin d’un uranium enrichi jusqu’à 20 %, que seule la Russie est actuellement en capacité de fournir.
« La dépendance au nucléaire est particulièrement forte parce qu’il ne s’agit pas simplement d’une dépendance à une matière, mais aussi à des technologies et des capacités industrielles », résume Yves Marignac, expert du nucléaire au sein de l’Association négaWatt, organisation militant pour la sobriété énergétique et le remplacement des énergies fossiles et nucléaires.
Le nucléaire à l’abri des sanctions
En avril, le Parlement européen appelait à un « embargo total » sur les importations de charbon, de pétrole, de gaz mais aussi de combustible nucléaire en provenance de Russie. Mais, après neuf mois de guerre et huit volets de sanctions, l’industrie de l’atome est l’un des rares secteurs à ne pas être concerné par les restrictions, au grand regret des dirigeants ukrainiens. Elle a même bénéficié d’exemptions : des avions cargo venant de Moscou et transportant du combustible destiné aux centrales slovaques ou hongroises ont été autorisés à circuler malgré la fermeture de l’espace aérien européen aux appareils russes.
En termes économiques, les pays de l’UE ont déboursé environ 210 millions d’euros pour les importations d’uranium brut de Russie en 2021. Si cette somme est bien inférieure à celle dépensée pour les achats de gaz ou de pétrole, elle masque d’autres gains indirects pour la Russie. « Il serait logique de sanctionner Rosatom, qui est impliqué dans l’occupation de la centrale ukrainienne de Zaporijia et donc complice de la stratégie de guerre de Moscou, mais personne ne l’a fait », constate Mark Hibbs.
Cette exception liée au nucléaire s’explique d’abord par le contexte énergétique. Alors que le conflit a privé les Européens de la quasi-totalité de leur approvisionnement en gaz russe, se passer de capacités de production nucléaire ajouterait au risque de pénuries d’électricité lors des prochains hivers, qui s’annoncent particulièrement tendus. De surcroît, l’UE est engagée dans un processus visant à réduire massivement ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à la fin de la décennie. En juillet, elle a choisi d’inclure le nucléaire, une source d’électricité bas carbone, dans la liste des investissements « verts » permettant de lutter contre le réchauffement.
Pour certains Etats, sanctionner Rosatom reviendrait aussi à rompre de multiples relations commerciales et des engagements de long terme. « Si le volet nucléaire était abordé dans le cadre des sanctions, il y a fort à parier que la Hongrie s’y opposerait », estime par exemple Phuc-Vinh Nguyen, expert à l’Institut Jacques-Delors.
L’inertie liée au nucléaire représente une autre difficulté. Si des sanctions étaient décidées, il faudrait sans doute des années pour mettre en place des alternatives fiables sans mettre en péril la sûreté des installations. La plupart des Etats ont des réserves d’uranium suffisantes pour faire fonctionner leurs réacteurs plusieurs mois, voire plusieurs années, mais conclure de nouveaux contrats d’approvisionnement peut être complexe et coûteux, tout comme développer de nouvelles capacités de conversion, d’enrichissement ou même d’expertise. « Compte tenu du déclin de l’industrie nucléaire ces dernières années, il existe un réel manque de personnes qualifiées qui pourraient venir en appui rapidement à des pays comme la Bulgarie ou la Slovaquie », complète Mark Hibbs.
Une domination russe remise en cause ?
La guerre en Ukraine, qui expose la dépendance de l’UE ou des Etats-Unis au nucléaire russe, aura-t-elle toutefois un impact sur cette industrie ? Selon Euratom, le fonctionnement du marché a été « profondément affecté » par les évolutions géopolitiques : « Cela a compromis la confiance dans ce qui était auparavant un partenaire majeur de l’énergie nucléaire, affaiblissant la sécurité d’approvisionnement de l’UE en matières et services nucléaires et aggravant ses problèmes de dépendance », écrit l’institution dans un rapport publié en août. « Compte tenu de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis et l’UE doivent désormais s’interroger sur la manière de réduire leur dépendance à Rosatom », conviennent aussi les porte-parole du groupe Orano (ex-Areva) en France.
De fait, si la plupart des experts estiment peu probable l’imposition de sanctions visant le nucléaire, la domination de Rosatom pourrait être en partie remise en cause, et le groupe perdre certaines parts de marché. Concernant la livraison de réacteurs, la Finlande a annulé un contrat passé avec Rosatom pour la construction de la centrale de Hanhikivi après le déclenchement du conflit. « Le rôle de développeur de nouvelles centrales du groupe russe va être restreint, estime Marc-Antoine Eyl-Mazzega. Il ne peut plus prêter comme avant à ses clients, la guerre compliquant l’accès aux financements. » « La première perte [liée à la guerre en Ukraine] pour le secteur nucléaire est la confiance en la Russie, et la seconde concerne les perspectives d’exportation de Rosatom », écrivait aussi en juin Jeremy Gordon, un consultant dans le domaine du nucléaire. Il soulignait alors que le vide laissé par Rosatom ouvrirait le marché à d’autres acteurs dont la France, la Corée du Sud ou le Royaume-Uni.
Conséquence très concrète de la guerre, le français Orano cherche aujourd’hui à développer ses capacités d’enrichissement d’uranium, soit en construisant une nouvelle installation aux Etats-Unis, où il est déjà impliqué, soit en augmentant d’environ 30 % la capacité actuelle de l’usine de Tricastin (Drôme). Pour cette seconde option, la Commission nationale du débat public (CNDP) a déjà été saisie par le groupe, et une concertation va être organisée dès 2023. « Il y a un intérêt manifeste de clients européens et américains qui souhaitent réduire leur dépendance à la Russie, explique-t-on chez Orano. Le processus serait plus rapide en France mais tout dépendra de la vitesse à laquelle les clients s’engageront. » Il n’est d’ailleurs pas le seul sur ce créneau du cycle amont, sur lequel le groupe anglo-germano-néerlandais Urenco pousse aussi ses pions.
Concernant les combustibles, l’américain Westinghouse avait commencé dès l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 à approvisionner certains réacteurs de type VVER en Ukraine. Il devrait compter à l’avenir de nouveaux clients tels que la République tchèque, qui se fournissait jusque-là auprès de la filiale de Rosatom TVEL. La Suède, pour sa part, a annulé ces derniers mois un contrat d’importation d’uranium russe. De son côté, le français Framatome développe un combustible sous licence achetée auprès des Russes, tout en travaillant à sa propre technologie pour la fin de la décennie.
Impulsion politique
Un réalignement du marché nécessitera néanmoins, à un moment ou à un autre, une impulsion politique. « Avant de mettre de l’argent dans de nouvelles capacités, les acteurs occidentaux vont se tourner vers les gouvernements pour qu’ils établissent des politiques claires, soulignait, en mai, Matt Bowen, chercheur au Centre sur la politique énergétique mondiale de l’université Columbia (Etats-Unis). Leur inquiétude est que dans un an ou deux, peut-être moins, les produits russes soient autorisés à revenir sur les marchés, ce qui leur ferait perdre leurs investissements. » Jusqu’ici, cependant, les acteurs et Etats qui réfléchissent à diversifier leurs sources d’approvisionnement le font en toute discrétion, les liens avec l’industrie nucléaire russe n’ayant suscité que peu de débats.
Une partie du monde semble par ailleurs peu encline à remettre en question la position dominante aujourd’hui occupée par Rosatom. Le groupe a entamé ces derniers mois le chantier de construction du premier réacteur d’Egypte à El-Dabaa, dans le nord du pays, et démarré en juillet celui du quatrième réacteur de la centrale d’Akkuyu, en Turquie. La Hongrie a donné en septembre son feu vert au lancement de deux nouvelles unités et, le 23 novembre, le Kirghizistan a annoncé qu’il allait étudier la possibilité de construire avec la Russie sa première centrale. Au total, le géant russe, qui n’a pas répondu aux questions du Monde, revendique encore trente-quatre projets à l’étranger pour un montant de 140 milliards de dollars.
La Russie possède la seule usine au monde capable de « recycler » l’uranium déchargé des réacteurs nucléaires français
Le groupe français Orano a continué à envoyer jusqu’en octobre de l’uranium en Sibérie, où se trouve une installation de conversion. La guerre en Ukraine pose la question de l’avenir de la filière du retraitement.
Par Perrine Mouterde et Marjorie Cessac Le Monde
A la différence d’autres pays d’Europe de l’Est, la France ne dépend pas de la Russie pour faire fonctionner ses 18 centrales. L’uranium naturel importé provient du Niger, du Kazakhstan, d’Ouzbékistan et d’Australie. Il peut ensuite être converti et enrichi dans les installations d’Orano sur les sites de Malvési (Aude) et du Tricastin (Drôme), les combustibles étant ensuite fabriqués dans les usines du français Framatome ou de l’américain Westinghouse.
Mais la guerre en Ukraine, qui expose la dépendance européenne et mondiale à l’industrie nucléaire russe, n’est pas totalement sans conséquences sur la filière française. Car aujourd’hui, une seule installation permet de « recycler » l’uranium issu des combustibles utilisés dans les 56 réacteurs du parc : l’usine de Seversk, située dans la région de Tomsk, en Sibérie, qui appartient au groupe russe Rosatom.
Un arrêt définitif du commerce d’uranium entre Paris et Moscou aurait inévitablement des conséquences sur une filière du retraitement déjà fragilisée et pourrait conduire, à terme, à ce que l’uranium issu des combustibles usés soit considéré comme un déchet supplémentaire à gérer, et non comme de la matière pouvant être réutilisée.
Ces deux dernières années, de l’uranium a été envoyé de la France vers la Russie. L’ONG antinucléaire Greenpeace a documenté au moins cinq livraisons entre janvier 2021 et janvier 2022 : 11 conteneurs chargés dans le port du Havre, le 12 février 2021, 20 conteneurs chargés à Dunkerque, le 29 octobre 2021, et 13 conteneurs dans le même port, en novembre 2021… Le 28 septembre 2022, soit sept mois après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, l’organisation révélait encore la présence du cargo russe Mikhail Dudin dans le port de Dunkerque.
« Les allers-retours ininterrompus de ce cargo entre Saint-Pétersbourg et Dunkerque trahissent à quel point l’industrie nucléaire française est prise au piège de sa dépendance à la Russie, dénonçait alors Pauline Boyer, chargée de campagne transition énergétique et nucléaire pour Greenpeace. La France doit de toute urgence stopper tout commerce d’énergie nucléaire avec la Russie. » Le secteur de l’atome ne fait pas l’objet de sanctions européennes.
Contrat soldé avec Rosatom
Le groupe français Orano, propriétaire d’uranium de retraitement (URT) provenant essentiellement de centrales étrangères et engagé par un contrat signé en 2020 avec Rosatom, a confirmé avoir effectué « cinq ou six livraisons » vers la Russie, pour un volume total de 1 150 tonnes. L’entreprise a toutefois révélé au Monde que ce contrat était désormais soldé, un dernier transport d’uranium ayant eu lieu en octobre 2022. Orano affirme par ailleurs ne pas envisager de signer de nouveau contrat avec le géant russe du nucléaire.
Pour EDF, qui exploite les centrales françaises et est donc propriétaire de l’uranium de retraitement issu des combustibles usés, l’enjeu est plus important. En 2018, l’électricien a signé un contrat avec une filiale de Rosatom, Tenex, pour la transformation d’URT, également à Seversk. En mars 2022, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire indiquait qu’EDF avait repris « depuis 2021 l’envoi de lots pour réenrichissement ».
Contactée, l’entreprise ne donne pas de précision sur la mise en œuvre de ce contrat, mais assure qu’« aucune livraison ni importation » d’uranium vers ou en provenance de Russie « n’ont eu lieu depuis février 2022 ». Selon les informations de Greenpeace, le gouvernement aurait sommé EDF de cesser ses exportations. Le ministère de la transition énergétique ne souhaite pas s’exprimer sur ce dossier.
EDF affirme par ailleurs avoir « engagé des discussions » avec Orano et avec Westinghouse pour mettre en place une installation de conversion de l’URT en Europe de l’Ouest. « La construction d’une usine prendra une dizaine d’années et décalera d’autant la réutilisation de cette matière, explique l’énergéticien. En attendant, l’URT sera stocké à Pierrelatte [Drôme], dans des entrepôts. » Fin octobre, Orano n’envisageait pas d’investir à court terme dans une installation de conversion, faute de débouchés suffisants. « Nous sommes à disposition s’il y a des besoins, mais il faut une réelle demande pour développer un nouvel atelier », expliquait le groupe, ajoutant que, « pour l’instant, il n’y [avait] pas d’urgence. »
La France est en effet l’un des seuls pays à avoir fait le choix du retraitement, et donc à avoir besoin de telles capacités. Une fois les assemblages de combustibles usés déchargés des centrales et refroidis, les éléments qui les composent sont séparés : les déchets ultimes (4 %) sont entreposés à La Hague (Manche) ; le plutonium (1 %) est expédié à Marcoule (Gard) pour fabriquer un nouveau combustible appelé MOX ; et l’uranium de retraitement (95 %) est envoyé vers les installations d’Orano à Pierrelatte. Officiellement destinés à être réutilisés, le plutonium et l’URT sont considérés comme des matières radioactives, et non comme des déchets.
Risque de saturation
De 1972 à 2010, plusieurs milliers de tonnes d’URT ont été envoyées vers la Russie. En 2010, ces exportations ont pris fin pour des raisons économiques – le cours de l’uranium naturel était bas –, mais aussi environnementales, le procédé alors utilisé pour la transformation de l’uranium à Seversk étant particulièrement polluant. Depuis 2013, la réutilisation de l’URT converti et réenrichi, possible uniquement dans la centrale de Cruas (Ardèche), est à l’arrêt. EDF confirme vouloir relancer cette utilisation en 2023 « a minima pour une recharge » afin de « refaire la démonstration du caractère recyclable de l’URT ».
Dans les entrepôts de Pierrelatte, près de 34 000 tonnes d’URT s’accumulent, les stocks augmentant d’environ 1 000 tonnes par an. En raison du risque de saturation, de nouvelles capacités d’entreposage doivent être mises en service prochainement. Une situation qui avait déjà poussé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à évoquer, en octobre 2020, « la perspective d’une éventuelle requalification de l’uranium de retraitement en déchet radioactif pour les volumes qui ne seraient pas utilisés ». Même si l’URT était réutilisé à partir de 2023, cela ne suffirait pas à compenser la production annuelle, expliquait le gendarme du nucléaire.
« Dans l’hypothèse où aucune perspective d’utilisation à long terme n’apparaîtrait pour l’uranium de retraitement, il conviendrait alors de le requalifier et de le gérer comme un déchet, répète aujourd’hui l’ASN. La décision de poursuivre ou non le retraitement appartient aux acteurs industriels et institutionnels. » « Soit un projet de conversion voit le jour en dehors de la Russie, soit il faudra se reposer la question de la qualification de cet URT », confirme Igor Le Bars, directeur de l’expertise de sûreté de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les opposants à l’atome dénoncent de longue date le choix du retraitement, considéré comme un moyen « d’entretenir l’illusion d’un cycle du combustible et d’un nucléaire “vert” », alors que cette option génère des coûts, des transports de matières et des déchets. Si l’industrie met en avant que 96 % des combustibles usés sont « valorisables », seul le plutonium est actuellement réutilisé.
L’usine de Melox (Gard), où est fabriqué le combustible MOX à partir de ce plutonium et d’uranium appauvri, a par ailleurs connu de grandes difficultés ces dernières années. La filière nucléaire défend au contraire l’idée que le retraitement permet de réduire la quantité d’uranium naturel excavée ainsi que les volumes de déchets.
Emmanuel Macron a dit vouloir de nouveaux réacteurs, au nom de l’indépendance énergétique de la France et de la préservation du climat. Mais où en est la filière et que suppose ce choix ?
Par Perrine Mouterde, Adrien Pécout et David Larousserie Le Monde
Quelle place la France doit-elle accorder au nucléaire dans le cadre de sa transition énergétique ? En annonçant, sans entrer dans le détail, mardi 9 novembre, sa volonté de relancer le programme nucléaire français, le président Emmanuel Macron a pris position et contribué à imposer le débat à cinq mois de la prochaine élection présidentielle.
Avec ses 56 réacteurs et ses quelque 70 % d’électricité d’origine nucléaire, la France jouit de l’un des systèmes électriques les plus décarbonés d’Europe. Mais son parc, construit entre les années 1970 et 1990, le deuxième plus important dans le monde derrière les Etats-Unis, est vieillissant : 36 ans de moyenne d’âge. Pour des raisons de vétusté, il devra en grande partie être mis à l’arrêt d’ici à la moitié du siècle.
Le pays sera donc amené à remplacer cette importante capacité de production électrique bas carbone. En parallèle, pour tenir ses objectifs climatiques et réduire sa consommation encore majoritaire d’énergies fossiles, il lui faudra surtout produire 35 % de térawattheures d’électricité de plus qu’aujourd’hui d’ici à 2050, selon le scénario central de Réseau de transport d’électricité (RTE), le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité.
Dans ce contexte, la France doit-elle lancer un programme afin de construire en série d’autres réacteurs de nouvelle génération, les EPR (sigle anglais pour « réacteur pressurisé européen ») ? Ou bien ferait-elle mieux de tout miser sur les énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire, et sortir progressivement du nucléaire ? A ce sujet, opinion, experts et politiques restent divisés.
De nouveaux réacteurs sont-ils indispensables face au défi climatique ?
Pour ses partisans, se passer de l’atome à l’heure de l’urgence climatique serait une aberration. Le nucléaire est, avec l’éolien, la source d’énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre au cours de son cycle de vie, soit de l’extraction du minerai au démantèlement des installations. D’après l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le nucléaire a permis d’éviter dans le monde au moins l’équivalent de 60 gigatonnes de CO2 depuis 1970, soit cinq années d’émissions mondiales du secteur électrique. Les réacteurs ont aussi l’avantage de produire de l’électricité à la demande et de manière continue, contrairement aux éoliennes et aux panneaux solaires, dont la production varie avec la météo ou le cycle jour/nuit. Ils sont, pour leurs défenseurs, un complément incontournable au développement des renouvelables.
Au niveau mondial, les grandes institutions, dont l’Agence internationale de l’énergie (AIE), misent sur une augmentation des capacités de production nucléaire au cours des prochaines décennies. « Le défi du changement climatique est tellement immense que nous ne pouvons nous permettre d’exclure des technologies bas carbone », estime Fatih Birol, le directeur général de l’AIE. La part globale de l’atome dans la production mondiale d’électricité restera toutefois limitée – moins de 10 %, selon l’AIE.
Pour les opposants au nucléaire en revanche, la construction de nouveaux réacteurs n’est pas nécessaire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Ils pointent d’abord la question des délais : en France, la mise en service d’une première paire d’EPR ne devrait pas intervenir avant, au mieux, 2035 ou 2040. Ils ne contribueront donc pas à la très forte réduction des émissions attendue d’ici à 2030. Des experts et des ONG avancent que la priorité, pour répondre rapidement au défi du réchauffement, est plutôt d’agir sur la maîtrise de la consommation et l’efficacité énergétique, tout en développant les renouvelables et les solutions de flexibilité, comme notamment le stockage par batterie. Dans son rapport publié le 25 octobre, le gestionnaire national RTE laisse le débat ouvert. Sur les six scénarios permettant tous d’atteindre la neutralité carbone en 2050, trois misent sur la mise en service de nouveaux réacteurs.
La filière est-elle capable de construire de nouveaux réacteurs ?
La France a longtemps vécu sur son parc historique. Une dizaine d’années sépare la mise en service du dernier réacteur inauguré à Civaux (Vienne), en 1999, et le lancement, en 2007, du chantier actuel de Flamanville (Manche). Un « trou » qui a notamment conduit à « une perte de compétences généralisée », comme l’a pointé en 2019 le rapport Folz portant sur les déboires du chantier de Flamanville.
Ces dernières années, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) s’est également inquiétée à plusieurs reprises de la « capacité industrielle d’EDF et des intervenants de la filière » dans le cadre des travaux colossaux engagés actuellement pour prolonger de dix ans l’activité des réacteurs déjà existants. Fin 2020, son président, Bernard Doroszczuk, rappelait que le secteur devait, d’une certaine façon, faire ses preuves : « La filière se mobilise pour qu’il y ait de nouveaux grands projets », mais « il faut d’abord qu’elle démontre sa capacité à réussir le réexamen » des réacteurs atteignant l’âge de 40 ans. « C’est en quelque sorte un test préalable », insistait-il.
Aujourd’hui, la filière se déclare « prête » à reprendre les grands travaux, comme le groupe Electricité de France (EDF) l’a encore affirmé, le 8 novembre, à l’occasion d’un point d’étape du « plan Excell ». Depuis 2019, le groupe coordonne ce « plan d’excellence de la filière nucléaire » visant à restaurer « la confiance » et à « fabriquer conforme du premier coup ». L’électricien national souligne qu’à la différence des premiers EPR, qui s’apparentaient à un prototype de tête de série, les nouveaux réacteurs reposeront sur une conception simplifiée. Par exemple, « la diversité des robinets en catalogue a été divisée par 10, passant de 13 000 [pour l’EPR de Flamanville] à 1 200 références [pour les futurs EPR]. »
En parallèle de Flamanville, EDF a participé au lancement effectif du premier EPR dans le monde en 2018 : celui de Taishan, en Chine, où une fuite de gaz rares a déjà entraîné une mise provisoire à l’arrêt. Le groupe mène aussi un projet, toujours en cours, au Royaume-Uni (Hinkley Point C). « Pour aller au bout des investissements nécessaires, les entreprises auront besoin de visibilité », souligne Cécile Arbouille, déléguée générale du Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire. La filière française, qui revendique 220 000 emplois directs et indirects, estime qu’une nouvelle paire de réacteurs pourrait représenter 10 000 emplois supplémentaires. Mme Arbouille espère attirer « les bonnes compétences au bon moment », alors que le pays manque par exemple de soudeurs, toutes filières confondues.
Combien coûterait la relance d’un programme nucléaire et qui le paierait ?
A Flamanville, la facture s’est envolée : de 3,3 milliards d’euros envisagés en 2007, l’enveloppe globale pourrait atteindre 19,1 milliards d’euros en 2023 (dont 12,4 milliards de coûts de construction), selon la Cour des comptes. Pour autant, EDF l’assure : le lancement de six nouveaux EPR permettrait d’abaisser les coûts, du fait d’une production en série. L’exploitant table aujourd’hui sur un coût de 46 milliards d’euros pour la construction de trois nouvelles paires de réacteurs, quand les ministères de la transition écologique et de l’économie envisagent déjà une fourchette supérieure, de 52 à 64 milliards d’euros, selon un document de travail révélé par le média Contexte.
Les modalités exactes du financement n’ont pas encore été tranchées, et ne seront pas neutres pour EDF (dont l’Etat détient la majorité des parts), déjà fortement endettée. Le déploiement de nouveaux réacteurs nécessiterait une implication des pouvoirs publics, par exemple sous forme de garantie d’emprunt. « Les coûts de production d’électricité dépendront beaucoup du schéma financier, un peu comme s’il s’agissait d’une voiture pour laquelle vous payez chaque mois, explique Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d’énergie nucléaire. Tout dépendra du taux auquel vous avez emprunté. » L’Etat lève en effet de l’argent sur les marchés à de bien meilleurs taux que les acteurs privés.
Dans son rapport du 25 octobre, RTE estime, en se fondant sur une hypothèse centrale d’un coût de financement assez faible (4 %), que construire de nouveaux réacteurs est « pertinent du point de vue économique ». Malgré des « coûts bruts de production des nouvelles centrales nucléaires (…) en moyenne plus élevés que ceux associés aux grands parcs d’énergies renouvelables », et malgré les montants nécessaires au retraitement et au stockage des déchets radioactifs comme au démantèlement futur des sites, les scénarios les plus nucléarisés « peuvent conduire, à long terme, à des coûts plus bas pour la collectivité qu’un scénario 100 % renouvelables ».
Pour le système électrique, la méthode de calcul retenue par RTE est celle des « coûts complets annualisés ». En raison de leur caractère intermittent, les énergies renouvelables comme l’éolien ou le solaire supposent davantage de capacités d’acheminement ou de flexibilité (stockage, pilotage de la demande et nouvelles centrales d’appoint).
La conclusion de RTE ne convainc pas les opposants au nucléaire, qui soulignent la très forte chute des coûts du solaire et de l’éolien observée ces dernières années. « En prenant en compte l’incertitude liée aux hypothèses [prises par RTE], les différents scénarios relèvent des mêmes ordres de grandeur en matière de coûts : il n’y a pas véritablement d’avantage économique du nucléaire », estime Greenpeace. Selon l’étude de RTE, le scénario du mix électrique à l’horizon 2060 le moins coûteux (et aussi le plus nucléarisé) représenterait 59 milliards d’euros par an, contre 80 milliards pour le scénario le plus onéreux (sans nouveau nucléaire).
Le nouveau nucléaire présente-t-il des gages de sûreté ?
Dans son bilan annuel 2020 sur l’état des installations du parc, Bernard Doroszczuk indique que la sûreté s’est « globalement améliorée » en 2020, tout en pointant la persistance de « points d’attention ». Les futurs EPR2, s’ils voient le jour, seront-ils plus sûrs que les réacteurs actuels ? Le gendarme du nucléaire a validé, en 2019, les « options de sûreté » proposées par EDF pour ces futures installations, qui devraient garantir le même niveau de sûreté que l’EPR de Flamanville.
« La vraie marche en matière de sûreté se trouve entre les réacteurs dits de deuxième génération, qui fonctionnent actuellement en France et dont la conception date des années 1970, et la troisième génération, dont font partie Flamanville 3 et les EPR2 », précise Julien Collet, le directeur général adjoint de l’ASN. La troisième génération prend notamment en compte, dès sa conception, le risque d’un accident avec fusion du cœur et celui d’agressions externes, telles que des séismes ou des inondations extrêmes.
Malgré ces progrès, les opposants rappellent que la France ne sera jamais totalement à l’abri d’un accident, citant les catastrophes de Tchernobyl (1986) et de Fukushima à la suite d’un tsunami (2011). Les conséquences pour les populations ou l’environnement peuvent être majeures. Ils estiment aussi que le système de contrôle de la sûreté, qui repose notamment sur le principe de la déclaration des incidents par EDF, n’est pas suffisant.
Sait-on gérer les déchets et démanteler les installations ?
Outre le risque d’accident ou d’atteintes à l’environnement, la gestion des déchets est le sujet qui préoccupe le plus les opposants au nucléaire. Fin 2019, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs stockait 1,67 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Les plus dangereux ne représentent qu’une toute petite part de ce volume : 3 % d’entre eux concentrent plus de 99 % de la radioactivité – ils resteront radioactifs jusqu’à des centaines de milliers d’années. Actuellement entreposés dans les installations d’Orano à La Hague (Manche), ils pourraient à terme être enfouis sous 500 mètres d’argile à Bure, dans la Meuse.
Le projet de Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), encore fortement contesté, attend sa reconnaissance d’utilité publique, qui pourrait être déclarée dans les prochaines semaines. A l’échelle mondiale, aucun site de stockage définitif de ces déchets de haute activité n’a encore été mis en service, à l’exception d’une installation pilote aux Etats-Unis pour des déchets issus du programme militaire.
Au-delà de Cigéo, l’ASN a multiplié les alertes concernant le risque que des « filières de gestion sûres » ne soient pas disponibles dans les quinze à vingt ans à venir pour les autres types de déchets, faute de décisions politiques rapides. A La Hague, les piscines où sont entreposés les combustibles usés seront saturées à l’horizon 2030. Même chose pour l’installation abritant les déchets très faiblement radioactifs à Morvilliers (Aube), alors que d’autres produits, comme des éléments conditionnés dans du bitume, n’ont toujours aucune solution de stockage pérenne.
Les partisans du nucléaire avancent, de leur côté, que la filière a fait la démonstration, depuis quarante ans, de sa capacité à gérer les déchets qu’elle produit sans impact sanitaire ou sur l’environnement. « Les déchets les plus dangereux sont en très petite quantité par rapport au service qu’ils nous rendent, insiste Myrto Tripathi, présidente de l’association Voix du nucléaire. Et Cigéo est une solution pour les gérer. »
Concernant le démantèlement, neuf réacteurs de quatre technologies différentes sont actuellement « en cours de déconstruction en France », selon EDF. Le plus ancien se trouve à Chinon (graphite gaz) et sa mise à l’arrêt remonte à… 1973. La déconstruction des réacteurs de deuxième génération (à eau pressurisée), qui constituent la majorité du parc, coûterait selon l’exploitant entre « 350 et 400 millions d’euros » par unité. Outre ceux de Fessenheim (Haut-Rhin) en 2020, seuls deux réacteurs de cette catégorie ont déjà été arrêtés sur le site de Chooz (Ardennes) : la fin de leur démantèlement est prévue pour 2024, soit trente-trois ans après leur mise à l’arrêt. A l’avenir, EDF espère accomplir ses prochaines déconstructions en une quinzaine d’années de travaux.
En quoi le nucléaire est-il un gage d’indépendance ?
Depuis le début, le nucléaire repose sur l’idée d’une certaine souveraineté de la France. En mars 1974, moins d’un an après le choc pétrolier, le plan Messmer, du nom du premier ministre d’alors, avait un objectif : se passer d’importations d’hydrocarbures pour la production nationale de l’électricité, à partir des centrales réparties dans le pays. Aujourd’hui encore, alors que la consommation d’énergie repose en France principalement sur des importations d’énergies fossiles, les partisans du nucléaire soulignent l’intérêt d’une source d’énergie produite sur le territoire.
En partie grâce à l’atome, la France produit sur son sol un peu plus de la moitié de son énergie consommée (54,6 % en 2019). Pour autant, ce pourcentage baisserait significativement si l’Agence internationale de l’énergie et Eurostat prenaient en compte l’origine du minerai nécessaire à la combustion nucléaire. Le pays importe environ 8 000 tonnes d’uranium naturel par an, notamment en provenance du Kazakhstan, du Canada et du Niger. « La géopolitique de l’uranium n’est pas du tout la même que celle des énergies fossiles, la répartition de l’uranium est plus homogène sur terre et il se stocke très facilement pendant plusieurs années », précise Michel Berthélemy, économiste à l’Agence pour l’énergie nucléaire, rattachée à l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Le minerai étant présent dans une variété de pays et sur tous les continents, les risques de dépendance à tel ou tel pays sont moindres. « L’uranium représente à peu près 5 % du coût global de production de l’électricité », indique le groupe Orano, spécialisé dans les métiers du combustible, pour signifier que les fluctuations des cours de ce minerai ne modifieraient qu’à la marge la facture totale.
Un débat démocratique est-il possible ?
Après l’annonce du président sur la construction de nouveaux réacteurs, les détracteurs du nucléaire ont dénoncé une décision « antidémocratique » et « unilatérale ». « S’il s’était exprimé en tant que candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron aurait été tout à fait légitime à se prononcer en faveur d’une relance du nucléaire, a par exemple réagi France Nature Environnement. Le problème, c’est qu’il a annoncé cette relance en tant que président. Les citoyennes et citoyens méritent d’être maîtres de l’avenir énergétique et décarboné de la France à travers un vrai et riche débat démocratique. » « Ce n’est pas en imposant des décisions depuis l’Elysée que l’on réussira notre transition énergétique », a aussi estimé Greenpeace.
De fait, la construction – ou non – de nouveaux réacteurs ne sera mise en œuvre que lors du prochain quinquennat, en fonction du candidat qui aura été élu. Avec cette annonce, Emmanuel Macron a surtout clarifié sa position dans le cadre de la campagne présidentielle. « Au moins ses intentions sont claires, estime Nicolas Goldberg, analyste énergie auprès du cabinet Colombus Consulting. Et il y aura forcément des débats au Parlement, dans le cadre d’un projet de loi de finances à propos du financement, autour de la régulation, pour la mise à jour de la programmation pluriannuelle de l’énergie… » Ce document, qui constitue la feuille de route énergétique de la France, doit être révisé d’ici à 2023.
Au Parlement, une quinzaine de députés ont déposé mi-octobre une proposition de loi pour renforcer les pouvoirs du Parlement sur la stratégie nucléaire, en instituant diverses mesures de transparence afin que les élus puissent se prononcer « de façon éclairée sur des choix qui engagent l’avenir de toute une nation ». Les citoyens pourraient être consultés lors du choix des sites retenus pour implanter de nouveaux réacteurs, si leur construction était effectivement lancée.
Où en est la recherche sur le nucléaire ?
Fin août 2019, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) décidait d’abandonner un projet de recherche sur un nouveau type de réacteur nucléaire, dit de quatrième génération, Astrid. « Astrid constituait le programme phare de la recherche nucléaire française. L’industrie nucléaire française ne dispose plus aujourd’hui de projet comparable de long terme, permettant aux chercheurs de confronter et valider de nouvelles options technologiques », résume un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques du 8 juillet (Opecst), qui craint « un risque de perte de l’acquis de soixante-dix ans de recherche ».
Sur les six concepts de quatrième génération qu’explorent Etats-Unis, Russie, Chine ou Inde, la France ne conserve des compétences que sur deux. La famille Astrid, dite des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, et celle dite des sels fondus, où le combustible est liquide, mélangé à des sels qui servent aussi de caloporteurs. Ces deux technologies consomment mieux l’uranium et peuvent aussi « brûler » le plutonium ou d’autres produits, permettant de réduire les déchets à traiter et de limiter les risques de dépendance à l’uranium.
Une autre voie de recherche est également explorée sans projet de prototype en France, les réacteurs pilotés par accélérateur de particules, pour transmuter la matière, c’est-à-dire transformer des éléments radioactifs en éléments de plus courte durée de vie ou moins actifs. Depuis octobre, le plan d’investissements France 2030 a porté l’attention sur les « petits réacteurs modulaires », de plus faible puissance et n’impliquant pas de rupture technologique. Le projet Nuward, entre notamment EDF et le CEA, doit déboucher sur un démonstrateur vers 2035. Mais il se destine principalement à l’export.
Finalement, le projet le plus concret en recherche nucléaire est le réacteur international ITER, en cours de construction dans les Bouches-du-Rhône, dont le but est de démontrer la capacité à générer de l’énergie par la fusion nucléaire, plutôt que par la fission, le principe qui anime jusqu’à présent tous les réacteurs.